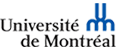Débat animé par Marion Vacheret, professeure titulaire à l'École de criminologie, Université de Montréal - CRDP
Les rationalités de la probation française
par Olivier Razac
Philosophe, enseignant-chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire appliquée au champ pénitentiaire, ENAP, France
« Depuis une vingtaine d'années, le champ de la probation française a connu des changements rapides, rythmés par une diversification des mesures pénales, une augmentation de la population suivie, mais aussi une série de textes réglementaires modifiant l'organisation des services et tentant de préciser, voire de redéfinir, la nature des missions. Cette évolution ne s'est pas déroulée sans provoquer des conflits révélateurs d'un problème de fond, qui réside dans la multiplicité des registres d'action que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation doivent manipuler dans les prises en charge. On peut diagnostiquer que cet éclectisme des pratiques pose à la fois des problèmes théoriques, éthiques et politiques, relatifs à la maîtrise des différentes connaissances nécessaires, à la pluralité des positionnements relationnels et à celle des formes de légitimation.
Cette recherche tente ainsi de définir le plus rigoureusement possible les rationalités qui structurent le fonctionnement de la probation française de manière à clarifier les types de relation qu'elles entretiennent. Six rationalités structurantes sont ainsi identifiées, chacune possédant une consistance et des exigences spécifiques : le pénal, l'éducatif, le social, le sanitaire, la gestion des risques criminels, la nouvelle gestion publique. La thèse principale de ce travail affirme qu'il n'est pas possible de postuler la synergie entre toutes ces rationalités, tant leur mise en relation ne peut manquer de provoquer de multiples contradictions, tensions et torsions du sens donné aux pratiques. La proposition essentielle qui en découle consiste à encourager l'élaboration de ce sens à partir des conditions concrètes de prise en charge et au plus près de ceux qui y sont impliqués. Il s'agit en particulier de proposer aux professionnels une grille de lecture éclairante de leurs différents registres d'action sans en estomper la complexité et les conflictualités. »
Les rationalités de la probation française. Olivier Razac (CIRAP), Fabien GOURIOU (CIAPHS) et Grégory SALLE (CLERSE), Cirap, mars 2013
&
Les trajectoires professionnelles des directeurs des services pénitentiaires
par Laurence Bessières
Sociologue, enseignant-chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire appliquée au champ pénitentiaire, ENAP, France
Par le prisme des carrières des directeurs des services pénitentiaires (DSP), il s'agit de participer à une meilleure compréhension du fonctionnement de l'organisation pénitentiaire. Deux dimensions sont privilégiées pour tenter de comprendre la manière dont les trajectoires professionnelles s'ordonnent et s'élaborent. La première normative permet de saisir le modèle faisant référence structuré autour de principes auxquels les DSP se conforment, notamment ceux de verticalité et de mobilité. La seconde, plus subjective, centrée sur les récits permet de déceler les jeux complexes qui s'élaborent autour des carrières. Les trajectoires professionnelles et la singularité de la carrière des cadres de l'administration pénitentiaire découlent de multiples transactions qui s'opèrent entre l'individu, son corps d'appartenance, l'institution pénitentiaire et de manière plus globale, des temporalités sociales qui scandent les cheminements individuels et qui démontrent encore une fois la porosité des champs de vie. Pour persévérer, continuer à avancer et ne pas abandonner, les DSP doivent en permanence prioriser, élaborer des compromis entre de multiples champs aux rationalités parfois divergentes.
Cette activité a fait l'objet d'une demande de reconnaissance aux fins de la formation continue du Barreau du Québec .